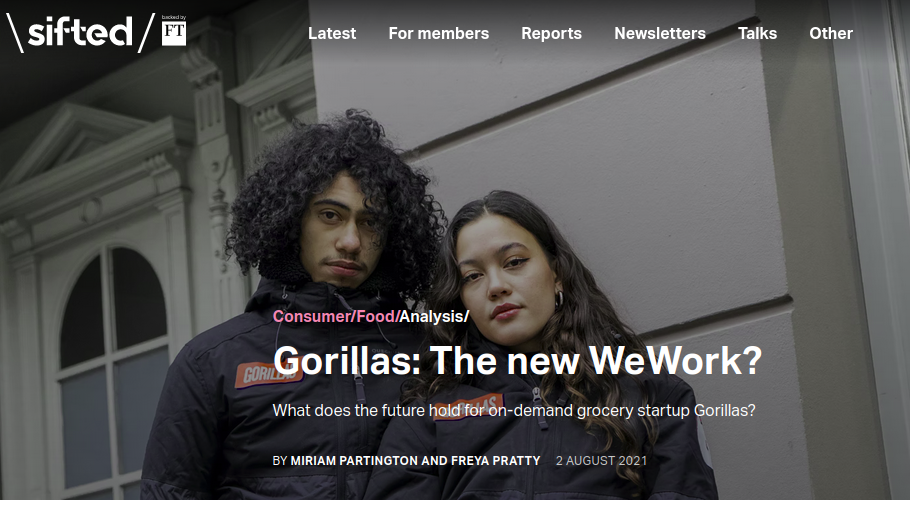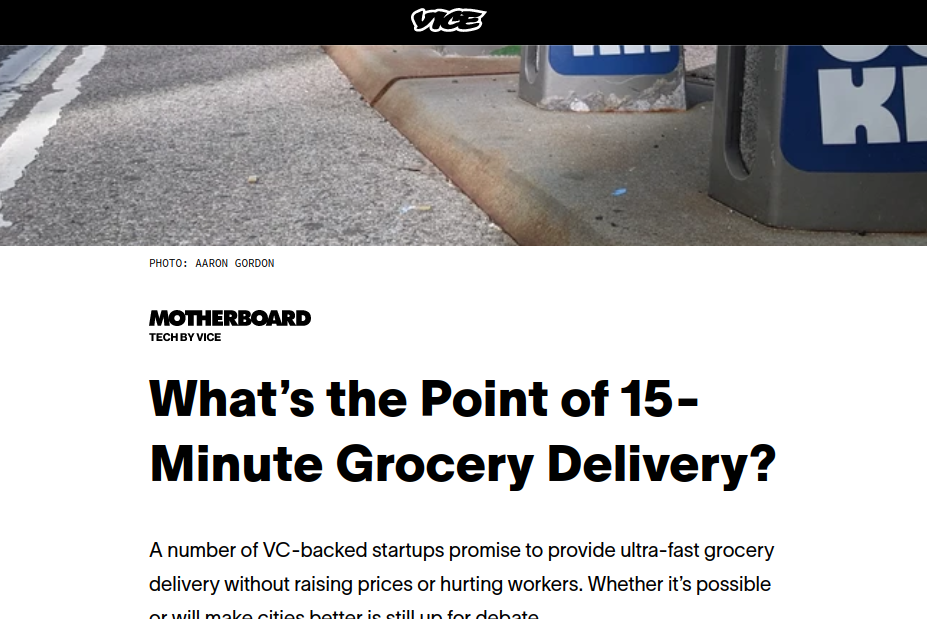Livraisons en 15 minutes : l'empire du moindre effort
Le temps que vous terminiez cette chronique, quelqu'un, dans une grande métropole occidentale, aura ouvert une application de livraison express pour commander un pack de bières, des chips, des couches pour le bébé voire un "avocat d'urgence" – le légume, pas le juriste – pour un apéro-guacamole impromptu après le boulot. À deux kilomètres de là (maximum), dans un entrepôt sans fenêtres ni clients, invisible du monde extérieur, un picker aura mécaniquement choisi les produits sélectionnés pour les empaqueter, en une à deux minutes. Le paquet aura été ensuite transmis à un livreur, qui aura enfourché son vélo électrique pour sonner à la porte du client anonyme, environ huit minutes plus tard. Abracadabra, l'apéro est sauvé ! Des millénaires d'innovation technique, et la civilisation moderne a enfin atteint son acmé.
En 2021, la recette miraculeuse du quick commerce – on dit aussi "q-commerce", car gagner du temps est primordial –, qui consiste à vous livrer chez vous, ce que vous voulez, en moins de quinze minutes, a révolutionné les comportements de consommation du spécimen urbain contemporain. Une quinzaine de start-ups européennes, créées pour la plupart en début d'année, est en plein battle royale pour atteindre le monopole des courses disruptées. Elle s'appellent Flink, Cajoo, Getir, Gorillas, Dija et une palanquée d'autres qui n'existeront probablement plus d'ici Noël. Leur modèle économique: vous livrer en des temps records (10 à 15 minutes), de 7 h à minuit, contre un coût de livraison dérisoire (environ deux euros) ou des prix à peine plus élevés qu'en magasin (environ 10 %).
Au détour d'une de leurs explorations dans les territoires vierges de la disruption, ces conquistadors sont tombés sur le Code du travail et l'ont ramené avec eux.
Leur arme secrète : un réseau de dark stores, des bâtiments vides reconvertis en entrepôts fantômes en pleine ville où sont stockés 1 500 à 2 000 produits de consommation courante plébiscités par les clients (contre environ 6 000 pour une supérette), qui permet aux livreurs d'être constamment à proximité du client à livrer. Et ne venez pas leur parler d'Uber eats ou Deliveroo : au détour d'une de leurs explorations dans les territoires vierges de la disruption, ces conquistadors sont tombés sur le Code du travail et l'ont ramené avec eux. Leurs employés sont (presque) tous en CDI (c'est écrit en gros sur les affiches), congés payés et arrêts maladie inclus, les vélos et l'équipement de sécurité (casque, gants, tenue, sac) sont fournis, il y a parfois des salles de repos à disposition pour chiller entre deux courses, et Gorillas va jusqu'à promettre des possibilités d'évolution de carrière à ses livreurs vers des postes de gestion. Miracle parmi les miracles : la disruption s'est retournée sur elle-même !
Alors que la demande en livraison a augmenté de 47 % depuis le début de la pandémie, confinement et couvre-feu oblige, ce marché de niche est une véritable orgie de capital : depuis le début de la pandémie, 14 milliards de dollars ont été englout… investis dans ces dizaines de start-ups, transformant quelques-unes d'entre elles en "licornes", ces jeunes sociétés au capital supérieur à un milliard de dollars. Getir, la doyenne du secteur, créée en 2015 en Turquie, pèserait par exemple aujourd'hui 7,5 milliards de dollars. Mais le meilleur exemple de cette hallucination collective reste certainement l'allemand Gorillas : lancée en mai 2020, devenue une licorne un an après et désormais valorisée autour des trois milliards de dollars, l'entreprise affichait 34 millions de dollars de chiffre d'affaires en janvier 2021, 196 millions en avril, et projetait 2,6 milliards de chiffre d'affaires annuel dans des documents internes obtenus par le site Sifted. Derrière, les disruptés (la grande distribution) et les ex-disrupteurs (Uber Eats, Deliveroo) se réorganisent, à grandes rasades de partenariats. Quitte à monter d'improbables édifices logistiques, comme le partenariat entre Carrefour, Uber et Cajoo, sorte de plan à trois de la sous-traitance qui réconcilie hypermarché et livraison ultra-rapide.
Une avalanche d'argent, de la libre et saine concurrence, des salariés sous contrat et des courses majoritairement livrées dans les délais : de quoi se plaint-on, me direz-vous ? Six mois après la première vague médiatique française, entre stupeur et scepticisme prudent, les conséquences sociales, économiques et urbanistiques de ces nouvelles habitudes de consommation commencent à apparaître plus clairement – et, ô surprise, le tableau n'est plus aussi joli. Début décembre, la journaliste de Numerama Aurore Gayte se faisait embaucher chez Gorillas pendant deux jours. Résultat : un rythme d'enfer, des sacs bien au-delà de la limite de poids recommandée de cinq kilos, des douleurs terribles au dos, des coursiers obligés de se mettre en danger au milieu de la circulation pour respecter la sacro-sainte contrainte de temps, du matériel défectueux…. ça fait beaucoup pour des livreurs payés 10,50 à 11,50 euros de l'heure (chez Gorillas).
"Au menu des doléances […] : douleurs chroniques, sacs trop lourds, vélos en mauvais état, salaires impayés."
La licorne allemande est au courant de ces problèmes : dans son pays d'origine, la grogne de ses employés, qui couvait depuis février et la création du Gorillas workers collective par une quinzaine de livreurs mécontents, s'est transformée en guerre ouverte : en juin et juillet, deux grèves ont éclaté et un entrepôt a été bloqué à Berlin. En novembre, l'entreprise a tout tenté pour bloquer la transformation du collectif en syndicat officiel, quitte à en passer par les tribunaux, sans succès. Au menu des doléances, écrit Vice : douleurs chroniques, sacs trop lourds, vélos en mauvais état, salaires impayés, etc, etc. Au QG, raconte Sifted, la culture d'entreprise est décrite comme "toxique" et "tyrannique", la stratégie du PDG "erratique" et opaque… Gorillas a un sacré air de famille avec WeWork, la start-up de location d'espaces de travail qui avait grandi trop vite et trop fort (évaluée brièvement à 47 milliards de dollars) avant d'exploser en vol en 2019, dans un crash qui n'en finit toujours pas. Ailleurs, ce n'est pas plus reluisant: grèves de livreurs en Australie, au Royaume-Uni, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Espagne ; mouvements de contestation en Inde et aux États-Unis… Livreurs, livreuses de tous les pays, unissez-vous !
Si l'exploitation de travailleurs jusqu'à la moëlle et la multiplication des magasins fantômes dans les centres-villes rappellent les grandes heures de la première vague d'ubérisation des livraisons à domicile – qui se souvient qu'en 2020, les cuisines fantômes parisiennes étaient un scandale social avant de devenir la nouvelle tendance l'année suivante ? –, le "modèle économique" n'a pas non plus bougé d'un iota par rapport aux précédentes générations de start-ups disruptives. Pour la majorité des structures, l'objectif est toujours le même : éviter la faillite et croître suffisamment longtemps pour se faire racheter par un concurrent plus gros et mieux financé. Dans cette optique, la rentabilité et la stabilité économique à long terme sont superflues. Regardons où en sont les pionniers : Uber a réalisé son premier bénéfice… au troisième trimestre 2021, plus de dix ans après son lancement. Deliveroo ? Que dalle, malgré une pandémie qui a doublé ses ventes, malgré son obstination à faire appel à des coursiers indépendants, ce à quoi il faut ajouter un bide monumental lors de son introduction en Bourse en mars dernier. Sans le cash gratuit des fonds d'investissements, le business de la livraison moderne n'existerait tout simplement plus.
Pire encore, il suffit de regarder l'état des précédents secteurs disruptés pour prophétiser l'avenir de la livraison à domicile : nous sommes actuellement dans la première phase, celle de la guerre économique sans merci, durant laquelle l'argent des investisseurs subventionne une part de ce que l'usager doit en théorie payer. Cette phase de subvention, qui a permis l'essor du mode de vie des jeunes urbains, où tout se commande à domicile sur son téléphone portable, est un mirage économique, rappelait le New York Times en juin 2021. Une fois cette phase d'écrémage terminée, une fois les nouvelles habitudes de consommation bien ancrées dans le temps et l'espace social, les entreprises encore debout, en situation de cartel, sifflent la fin de la récré.
Que restera-t-il, alors, une fois la poussière retombée et les cadavres de start-ups enterrés ? Un nouveau monde, dans lequel le temps sera (encore) un peu plus compressé.
Vous vous rappelez quand Uber coûtait deux fois moins cher qu'un taxi et les chauffeurs étaient confortablement payés? Un mirage. Rien qu'entre 2018 et 2021, le prix des courses a augmenté de 92 % aux États-Unis. Vous vous souvenez quand Frichti employait 150 livreurs sous contrat ? Quand Deliveroo payait à l'heure ? Mirage et paillettes. Voilà ce qu'il va se passer : lorsqu'il n'y aura plus de millions de dollars à incinérer, les prix vont augmenter, les conditions des travailleurs se dégrader. En octobre, Quartz a sorti la calculette, et affirme que les frais de livraison devraient se situer entre 5 et 10 dollars par commande pour envisager une rentabilité.
Sceptique ? Regardez outre-Atlantique. Uber Eats, DoorDash et GrubHub contrôlent 98 % du marché de la livraison. Les frais de livraison ont tellement augmenté (jusqu'à 50 % du coût de la commande chez DoorDash) que les régulateurs préparent un projet de loi pour mettre fin à ces pratiques de cartel. Vous voulez la meilleure ? Début 2022, la promesse centrale de la livraison en 15 minutes est en train de s'évanouir : aux États-Unis, la start-up Jokr, qui pèse 1,2 milliards de dollars et perd 159 dollars par commande, vient d'annoncer à ses investisseurs qu'elle souhaitait passer à un modèle de souscription et abandonner la livraison en quinze minutes. Le mirage s'efface déjà. "Quel est l'intérêt?", alors, s'interroge Vice. Aucun, évidemment, excepté le profit. Personne n'a besoin de la livraison ultra-rapide dans des villes saturées de commerces de proximité (un Franprix tous les 350 mètres à Paris).
Que restera-t-il, alors, une fois la poussière retombée et les cadavres de start-ups enterrés? Un nouveau monde, dans lequel le temps sera (encore) un peu plus compressé. Ne faisons pas l'erreur de nous croire imperméables à la tentation de Gorillas et des autres, à leur promesse de gratification instantanée. Nous flancherons, assure The Conversation. Il ne faut que six semaines pour créer une habitude. Nous avons déjà flanché devant la restauration rapide (en trente ans, le temps moyen de pause déjeuner est passé d'une heure et demie à 30 minutes), devant Uber, Uber eats et toute cette économie de services superflus qui, en modifiant notre rapport à la commodité, ont ancré en nous l'idée que le temps doit être en permanence mis à profit. Car si le concept de la livraison à domicile n'a rien de nouveau (comme l'illustre la photo en tête d'article), c'est bien l'infernale accélération du temps social qui reconfigure nos espaces.
L'ethostechno-solutionniste propose l'élimination maniaque de tout contretemps, convainc une génération entière que l'interaction humaine est uneexternalité négativedu processus marchand.
Uber et Lyft ont déjà empiré les conditions de circulation dans les centres urbains, concluait Bloomberg plus tôt cette année ; une économie entière basée sur la livraison serait un enfer logistique dans des villes déjà congestionnées. Aujourd'hui, la prolifération des magasins fantômes accélère encore le processus de gentrification des centres-villes, aussi bien à Londres qu'à Paris, où l'adjoint écologiste à la mairie de Paris David Belliard constate, dans Libération
, "qu'il y a de la monoactivité, des endroits où on ne trouve plus que des dark stores et pas de commerces de proximité", au mépris des plans locaux d'urbanisme et des supérettes de quartier, et met en garde contre l'émergence d'une "dark city" – une ville fantôme strictement fonctionnelle, atomisée et optimisée, aux devantures aveugles et aux trottoirs déserts, sans flâneurs ni rassemblements, entièrement dédiée à l'économie servicielle.
Il ne s'agit pas de pleurer la mort des Franprix et autres rejetons locaux de la grande distribution, qui ont tout intérêt économique à s'allier avec les disrupteurs de l'épicerie à domicile – un entrepôt fantôme rempli par analyse algorithmique des tendances de consommation et sous-traité à une start-up, c'est probablement moins cher qu'une supérette. Il s'agit d'avertir de la raréfaction de l'imprévu dans l'expérience urbaine. De mettre en garde contre la tendance technocratique à l'efficacité, qui abhorre les intermédiaires, au premier rang desquels les commerçants de quartier et autres experts dans l'art du papotage. Derrière l'émergence d'une "économie de la flemme", longuement explorée par le Figaro, ce qui se joue, c'est une érosion du sentiment de communauté et, en miroir, un renforcement du sentiment d'individualité, à un moment charnière de nos sociétés où nous devrions justement refuser collectivement l'archipelisation de l'espace induite par la pandémie. Ça tombe bien, il existe une autre "ville du quart d'heure", théorisée par Carlos Moreno, dont Paris se targue justement d'être la "capitale mondiale". Le principe : mettre les services de proximité à quinze minutes à pied de chaque habitant. À condition qu'ils veuillent encore sortir de chez eux.
À l'heure où nous souffrons comme jamais d'isolement et que la cohésion sociale s'érode partout, l'ethos
techno-solutionniste propose l'élimination maniaque de tout contretemps, convainc une génération entière que l'interaction humaine est une externalité négative
du processus marchand, et entretient l'idée que le dehors et l'altérité sont synonymes de menaces biologiques et terroristes. Nous avons plus que jamais besoin de sortir, de nous réunir, d'éprouver la friction et la mixtion de nos corps, de fracturer le temps productif achronique qu'installe le télétravail, et tout simplement de s'aérer l'esprit. La livraison en quinze minutes propose l'exact inverse – s'enfermer chez soi, reclus dans sa monade, coûte que coûte. Pourrir un peu plus dans un désert cognitif, chacun dans sa déréliction individuelle. Une désertion du dehors au profit du dedans, un abandon du mouvement au profit du statique. Pour quoi faire ? Continuer à bosser, manger et dormir dans cet espace domestique imperméable. La livraison à domicile divise la ville en deux classes étanches, caractérisées par un rapport inverse à l'espace et à l'effort: ceux du dedans, immobiles, et ceux du dehors, en mouvement perpétuel (et dans leurs rangs, au terminus de l'invisible, ces sans-papiers qui louent des identités numériques pour survivre). Vous pouvez arrêter de me lire – vos courses viennent d'arriver. Pile dans les temps. L'apéro est sauvé. Abracadabra.
Cet article est libre d’accès
En vous abonnant, vous contribuez
à une information sur les médias
indépendante et sans pub.
Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous