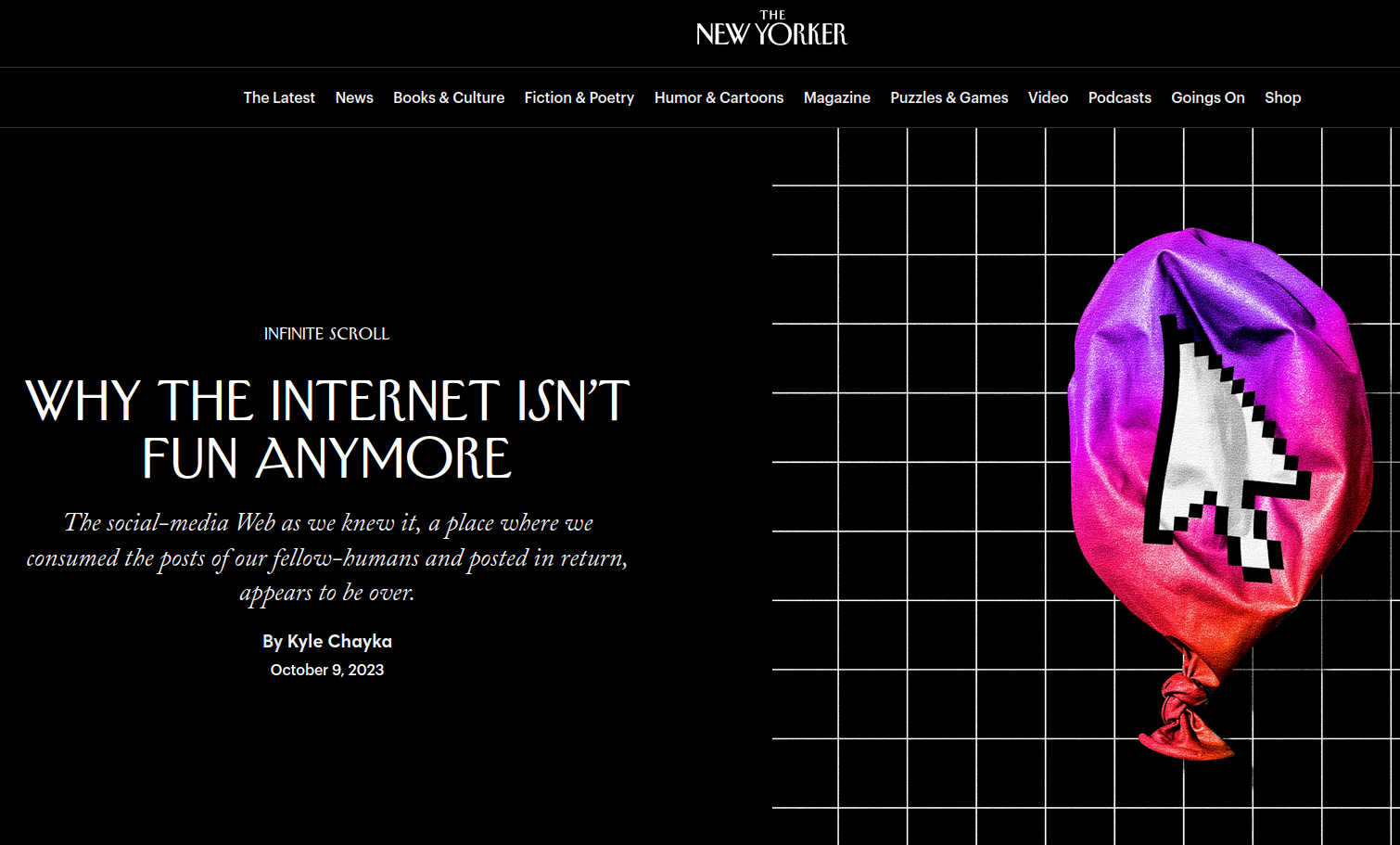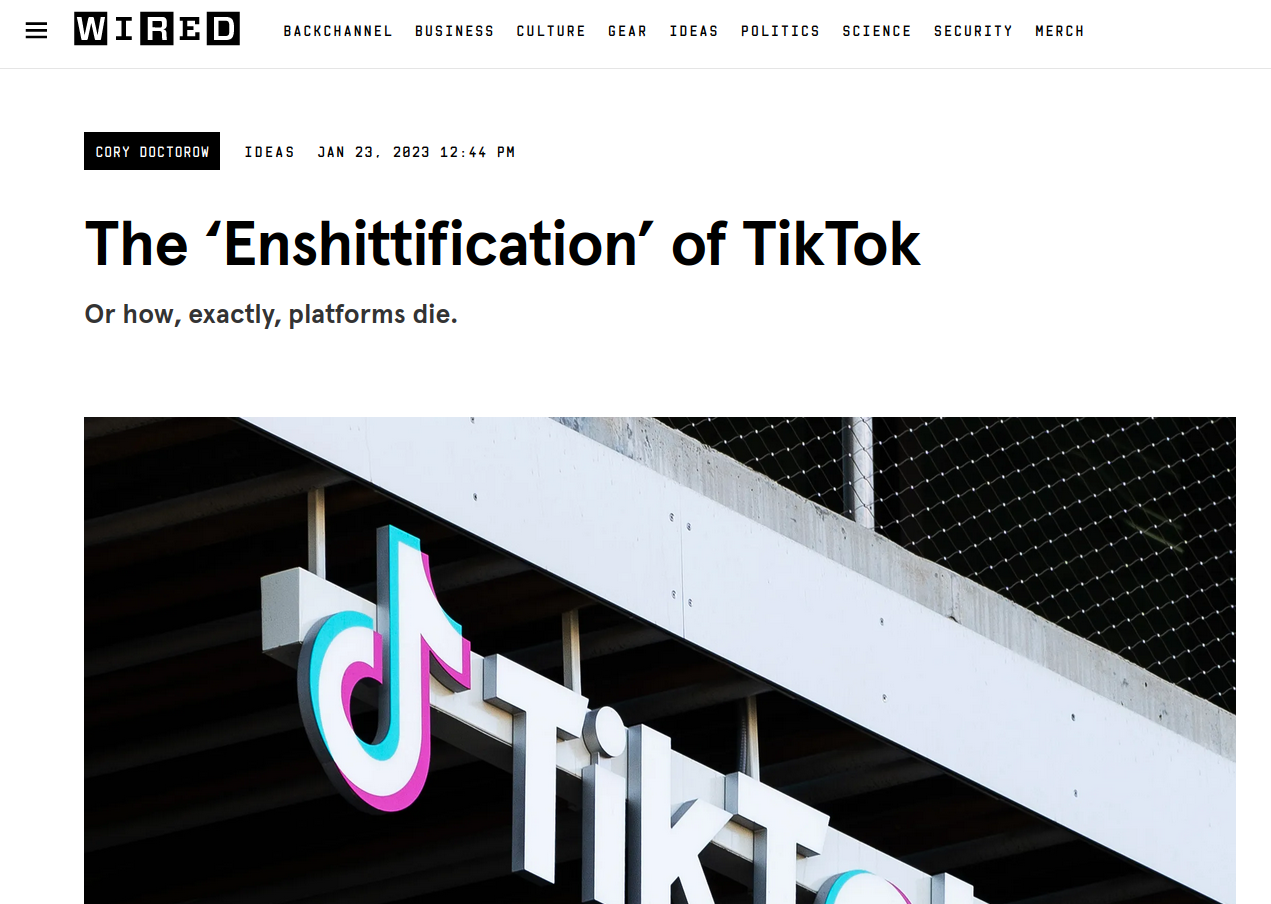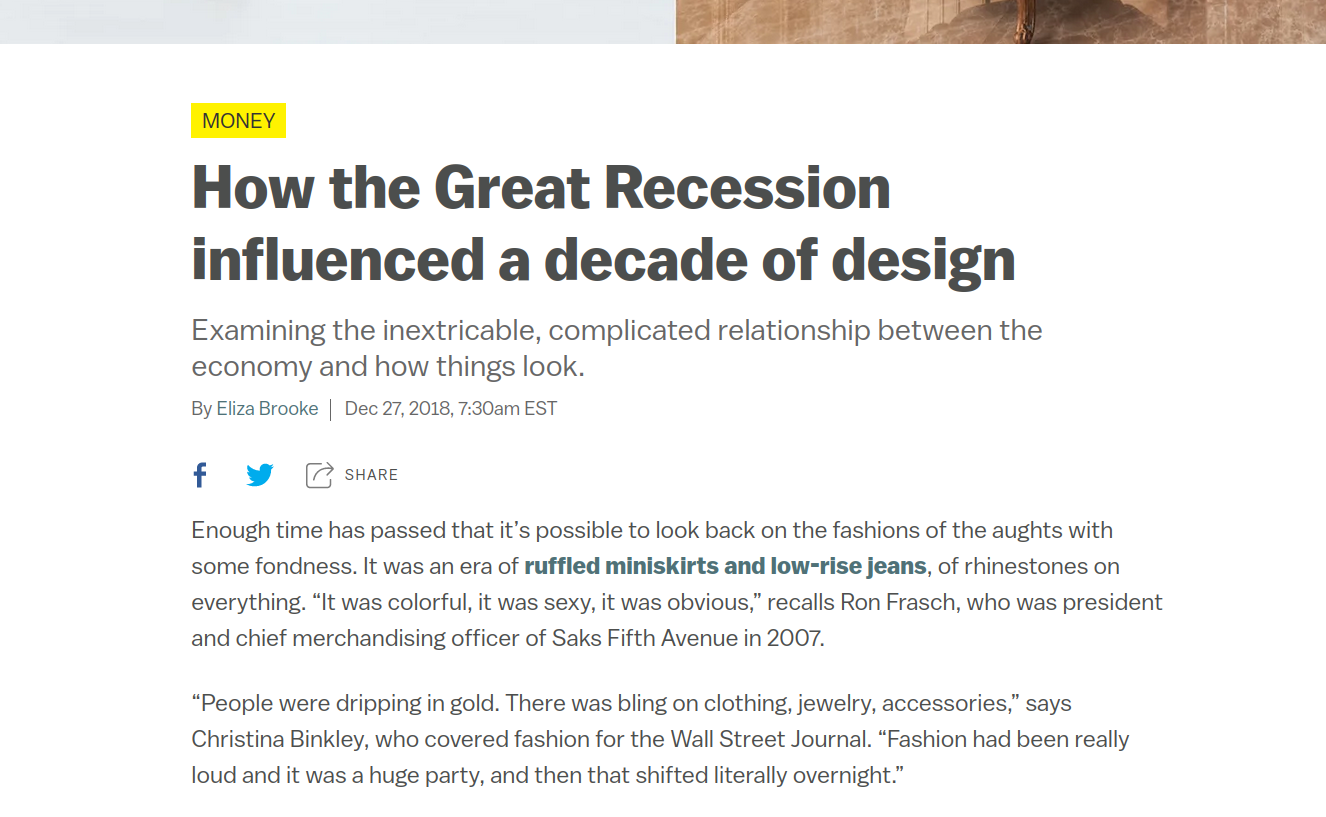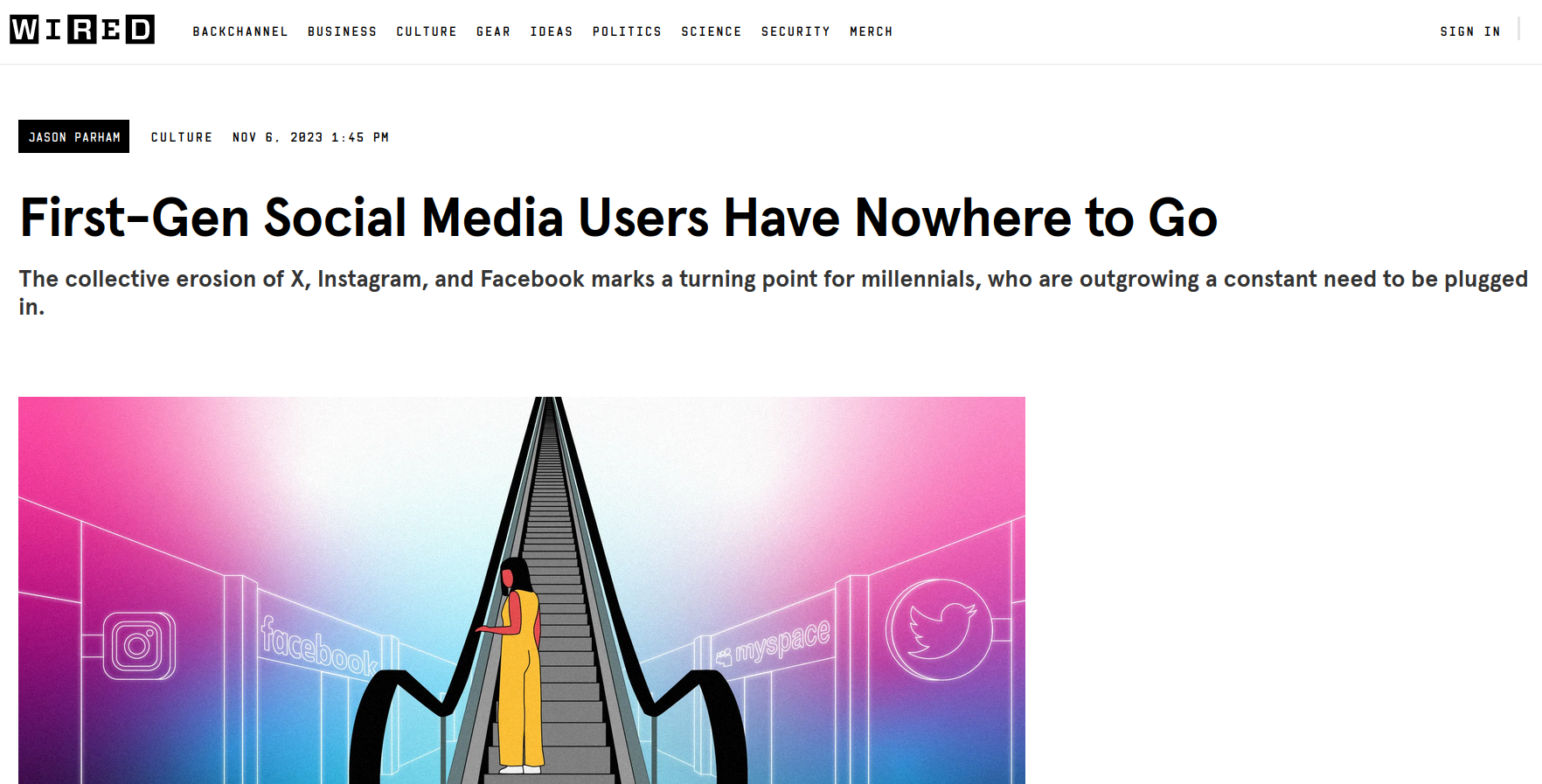Aux apatrides du web merdique

Ça y est, c'est la fin. Le web ferme boutique. Enfin, pas n'importe quel web, certes – le web social, celui qui domine l'écosystème de l'information depuis 2010. Vous n'êtes pas au courant ? Pourtant, les épitaphes se multiplient dans la presse tech (nocritique) depuis quelques mois, autant aux États-Unis que sur nos terres hexagonales. Petit florilège. Le 30 décembre, Wired décrivait 2023 comme "l'année où l'Internet millennial est mort". En octobre, le New Yorker nous expliquait, en se rappelant du bon vieux temps, pourquoi "Internet a cessé d'être fun" (spoiler alert : l'article décrit essentiellement le destin des réseaux sociaux, ce qui n'a pas grand chose à voir avec "Internet"). En avril, Ellis Hamburger promettait, après sept ans passés chez Snapchat, que "les réseaux sociaux sont destinés à mourir". Même son de cloche chez l'éditorialiste Ed Zitron, qui affirmait en février que "les réseaux sociaux sont en train de mourir", tandis que la LA Times balançait la même prophétie en août. Gradation finale dans l'oracle, certains médias, comme Business Insider ou Vice, affirment au présent que les "réseaux sociaux sont morts", et qu'ils auraient entraîné avec eux leur cohorte maudite d'influenceurs, de marketeux et de monétiseurs d'attention. (Cherchez "social media is dead" sur Google, et vous comprendrez l'ampleur de l'angoisse qui étreint la classe disruptrice des années 2010.) Même le réputé technocritique Ian Bogost se muait en prophète dans The Atlantic dès 2022 : "L'ère des réseaux sociaux touche à sa fin – et elle n'aurait jamais dû commencer."
Il faut se rendre compte de l'énormité du virage idéologique pris par une partie de la presse spécialisée. Pendant plus d'une décennie, la croissance et la consolidation des oligopoles du Web a semblé si inexorable, si effroyable, si totale, qu'envisager les scénarios de leur chute relevait du blasphématoire ou du délirant. Une pandémie plus tard, des journalistes tech dansent joyeusement sur les cadavres des titans supranationaux de la décennie 2010, comme si c'était la chose la plus inéluctable qui soit. Est-ce réellement le cas, ou assiste-t-on simplement à la vague de nostalgie d'une génération d'ex-jeunes journalistes nés dans le web des blogs, venus au métier avec le web social et devenus progressivement des trentenaires déconcertés par les usages numériques de la génération suivante ? Y aurait-il un peu des deux? Si le web millennial est mort, penchons-nous au moins sur le cadavre pour une petite séance d'autopsie.
Ce sentiment de déliquescence part d'un constat simple : plus le temps passe, plus le web social, né autour de l'an de grâce 2005, devient merdique. J'écris "merdique" à dessein : l'emmerdification (enshittification) du Web est un concept, formulé en version beta fin 2022 par l'infatigable technocritique Cory Doctorow, qui n'a depuis cessé de le polir. Dans sa version la plus concise, datée de janvier 2023, le principe d'emmerdification postule que "premièrement, [les plateformes] séduisent leurs utilisateurs ; ensuite, elles les exploitent au profit de leurs clients ; pour finir, elles exploitent leurs clients pour récupérer toute la valeur produite. Enfin, elles meurent." La puissance de l'analyse de Doctorow réside dans l'idée que la détérioration des services offerts par le capitalisme de plateforme n'est pas circonstancielle mais structurelle, inhérente au modèle lui-même, qui n'a jamais été conçu pour durer mais pour capter un maximum de valeur en un minimum de temps quitte à tout détruire sur son passage – "Move fast and break things".
Pour détrôner MySpace, Facebook a d'abord cherché à nous montrer ce qui nous plaisait, tout en facilitant au maximum le transfert d'utilisateurs vers sa plateforme. L'effet de réseau, selon lequel un système gagne en valeur à mesure que son nombre d'utilisateurs augmente, a joué à fond. Les gens rejoignaient Facebook parce que leurs proches étaient sur Facebook, ce qui encourageait d'autres gens à rejoindre Facebook. Une fois une masse critique atteinte et sa position dominante assurée, la plateforme s'est transformée en un jardin emmuré, emprisonnant ses utilisateurs dans un enclos panoptique où chacun de leurs posts était surveillé, analysé et exploité au profit des annonceurs. Petit à petit, le site est devenu hostile, ennuyeux et globalement invivable. La même chose se produit sur les autres plateformes. Les disrupteurs frénétiques de 2005, pleins de fonctionnalités et d'usages inédits, sont devenus les monopoles ronronnants de 2020, où nous tournons sans but dans des aquariums informationnels saumâtres.
Et pourtant, nous restons, parce que le coût de transfert (switching cost) social, technique et psychologique vers une autre plateforme était trop important – combien d'entre vous ont laissé leur compte Facebook en friche mais utilisent toujours Messenger pour communiquer avec leurs amis, par simple habitude ? Cette notion est absolument centrale dans la stratégie de croissance des plateformes, car qui dit coût de transfert élevé dit monopole, et dit captation maximale des profits. Facebook et les autres plateformes, explique ce même Cory Doctorow, font donc tout leur possible pour garder ce coût aussi élevé que possible, car "l'effet de réseau permet de gagner des utilisateurs, et le coût de transfert les prend en otage." C'est pour cette raison que les produits Apple sont irréparables, et qu'aucune des plateformes ne facilite l'inter-opérabilité. C'est pour cette raison qu'en 2024, le web n'est pas un outil de libération et de partage mais d'emprisonnement et de captation. Et le cancer du modèle des plateformes – surveillance, extraction, emprisonnement – s'étend doucement au moindre objet disposant d'un circuit électronique.
L'emmerdification du capitalisme de plateforme n'est pas un accident, encore moins une évolution naturelle de l'écosystème numérique : elle est le résultat d'une idéologie mortifère et d'une série de choix stratégiques délibérés, effectués en toute connaissance des enjeux, et contre les intérêts du plus grand nombre. Comme j'ai pu le lire au détour d'une newsletter, "le principe de base du capitalisme est l'emmerdification généralisée du monde". Puisque nous vivons désormais sous le régime du merdique éphémère, rien d'étonnant à ce que les infrastructures numériques contemporaines reflètent cette hégémonie politique.
Aujourd'hui, où en sommes-nous de l'emmerdification générale ? Au stade terminal. Facebook, toute honte bue, vous propose de payer dix balles par mois pour respecter votre droit fondamental à la vie privée, après vous avoir consciencieusement transformé en matière première. Chez Twitter c'est 8 euros, sur Spotify c'est 10, sur Youtube c'est 13 et chez Netflix, inflation oblige, c'est passé à 13,50. Sortez les CB, l'ère de la gratuité est terminée. La télé câblée est de retour. Zuckerberg, encore lui, vient de passer deux ans à nous persuader, sans succès, qu'enfiler pendant des heures des casques de VR qui foutent la gerbe pour s'incarner en avatars sans jambes dans des déserts pixellisés était la prochaine étape de la transcendance humaine. Sa dernière trouvaille : répondre à la fuite des utilisateurs humains – car, enfin, nous n'avons plus assez eu à perdre – en peuplant ses plateformes de PNJ foireux dopés à l'IA.
Twitter, devenu X depuis qu'il est dirigé par un adulescent d'extrême-droite, a tellement salopé l'information que le concept de réalité consensuelle nous semble désormais utopique. L'outil anti-censure du citizen journalism, des Printemps arabes et de Black Lives Matter, est devenu un bouillon de culture radioactif où batifolent cryptobots, actrices de soft porn et propagandistes fafoïdes venues de tout l'Occident suprémaciste et masculiniste. Dans le supermarché du dropshipping qu'est devenu Instagram, des automates influenceurs vendent sans relâche des produits contrefaits à des armées de bots. Google News est plein d'articles générés par IA, et ce ne serait que le début du processus de generative inbreeding – les logiciels d'IA entraînés sur du contenu générés par d'autres IA –, qui devrait aboutir à la destruction totale de la culture humaine. Même un truc aussi fondamental que le moteur de recherche Google s'est dégradé, irrémédiablement infecté par du contenu publicitaire, avertissait récemment 404 Media.
En 2024, le web social tout entier n'est qu'un satellite de TikTok, ce trou noir supermassif au centre de la galaxie du réel. Le text-based Internet est devenu l'empire du sludge content, des vidéos de pure stimulation audiovisuelle conçues sur-mesure pour le business de l'attention. La chambre d'écho algorithmique, cette machine à radicaliser qui devait détruire les démocraties circa 2015, a laissé place à une algorithmie de tous les possibles, qui isole chaque individu dans son infini individuel. La viralité, cette machine à célébrité numérique instantanée capable de
construire et de démolir des vies humaines, s'est arrêtée. Le web n'a jamais été aussi riche, aussi peuplé et aussi inaccessible. Vous
n'avez jamais vu les vidéos les plus visionnées de TikTok. Vous ne connaissez pas la série la plus vue de Netflix. Le web s'évapore – oui, le vapor web est déjà un concept journalistique déposé – comme une bibliothèque infinie de Borges, sans index pour s'y repérer.
Ne nous resteraient alors que deux choix : doomscroller sur les plateformes traditionnelles pour revoir passer les mêmes vidéos recyclées de TikTok jusqu'à l'effondrement total de notre autonomie cognitive, ou se planquer dans les interstices conversationnels du dark social (Whatsapp, Telegram, Discord, etc), où chaque petit groupe pourra tranquillement construire sa propre réalité synthétique sur-mesure, étanche et balkanisée, au chaud derrière des murs capitonnés. Safe. Il y a un concept pour ça : le web de la forêt noire (dark forest web), où chaque communauté fait tout pour rester dans son entre-soi, invisible aux autres. La migration vers ce private networking a déjà commencé : nous, les gens normaux, ni influenceureuses, ni créateurices, ni robots, postons déjà moins de contenu que l'année passée.
L'emmerdification ne se limite évidemment pas aux réseaux sociaux ; elle s'étend à toute l'économie des plateformes. Pas étonnant que le concept ait été élu "mot de l'année 2023" par la maison d'édition indépendante Verso Books, tant il incarne le zeitgeist tech des 12 mois écoulés. Voire de toute la décennie passée. Nous vivons indéniablement la fin d'une époque. La fin d'un mirage économique débuté en 2008, au sortir de la crise mondiale des subprimes, et qui connaît donc son crépuscule dans un contexte de "polycrise" – un concept inventé par Edgar Morin en 1999 qui tente de saisir l'intersection des crises géopolitiques, économiques, politiques et climatiques. Une décennie marquée, post-subprimes, par une politique de taux d'intérêts historiquement bas (de 2008 à 2015, le taux d'emprunt de la Fed étasunienne avait été réduit à... zéro), qui voyait l’État étasunien subventionner les investisseurs afin de relancer l'activité.
L'économie politique du blitzscaling, des Uber et des Airbnb quasi-gratuits, des palaces de la débauche WeWork loués pour trois fois rien, des cimetières de vélos en free floating, des trottinettes électriques à 1 euro le trajet, des licornes surévaluées, des livraisons de bouffe en 15 minutes et des arnaques à la Juicero (l'extracteur de jus connecté qui ne servait à rien, mais levait 120 millions de dollars en 2014) restera probablement dans l'histoire des sociétés comme un court épisode de délire collectif symptomatique du capitalisme tardif. Mais les conséquences de
la bulle web 2.0, qui a quand même réussi à marcher pendant 15 ans au
mépris des lois élémentaires de l'économie de marché, sont profondes. Cette bouffée délirante a défini le quotidien de toute une génération – la mienne, celle des millennials, simultanément paupérisée par la violence néolibérale post-2008 et subventionnée au quotidien par une génération de start-ups étasunienne brûlant des montagnes de dollars en pleine épiphanie messianique (pour vous donner une idée de l'ambiance, jetez un oeil à la mini-série WeCrashed). Une culture sociotechnique tout entière s'est développée sur des conditions macroéconomiques aberrantes et des oracles financiers dignes d'une secte millénariste.
Ce qui nous a échappé, en apesanteur dans nos AirSpace minimalistes à ampoules Edison et fausses briques apparentes, c'est que notre millennial lifestyle de jeune adulte posait simultanément les bases du nouveau contrat social néolibéral : partout où ce serait possible, une start-up à but lucratif remplacerait un service public, puisque ça fonctionnait si bien. On appellerait ça l'ubérisation. Le succès d'Uber, écrivent les auteurs de Disrupting D.C.: The Rise of Uber and the Fall of the City, a ainsi converti toute une génération au dogme néolibéral : poser la privatisation comme axiome, et considérer la puissance publique comme une relique du vieux monde.
Aujourd'hui, la bamboche est terminée. Depuis la pandémie, écrit Wired,
les mêmes banques centrales dont les choix politiques de 2008 ont
accouché du web 2.0 sont tout simplement en train de nous en sortir
brutalement. Le taux d'emprunt étasunien est actuellement à 5 %, au plus
haut depuis 2006. L'argent a cessé d'être gratuit. Conséquence immédiate
: en 2022, les Gafam perdaient de 30 à 60 % de leur capitalisation
boursière. Depuis deux ans, l'industrie de la tech étasunienne a
licencié près de 450 000 personnes. Ce n'est pas que "l'Internet des trentenaires" décrit par David-Julien Rahmil pour l'ADN qui est en train de crever : le millennial lifestyle, son équivalent physique, meurt en même temps que ses plateformes, nous prévenaient The Atlantic et le New York Times l'année passée. Le
quotidien s'emmerdifie à son tour. L'addition réelle est enfin arrivée,
et ça pique. Un Uber coûte aussi cher qu'un taxi, un Airbnb coûte plus
cher qu'un hôtel (142 euros par nuit en moyenne, augmentation de 36%
entre 2019 et 2022). Cerise sur le gâteau : dix ans après, aucune des
deux entreprises n'arrive à dégager un profit stable, même en tordant leurs bilans financiers autant que possible. Bullshit un jour, bullshit toujours.
Ce qui reste, en revanche, c'est l'inféodation des politiques publiques aux priorités de l'oligarchie actionnariale, l'accélération de la casse du salariat et la création ex nihilo, en quelques années à peine, d'une nouvelle classe mondiale de prolétaires. Ce sont ces légions de chauffeurs Uber, travailleurs du clic, employés de dark kitchens, micro-tâcherons d'Amazon Turk, modérateurs d'IA au Kenya, au Mexique, au Nigeria ou aux Philippines, livreurs à vélo, préparateurs de commandes Amazon et gig workers, sans protection sociale (et de plus en plus souvent sans titre de séjour), précarisés jusqu'à l'os, soumis quotidiennement à l'inhumanité d'un management algorithmique et dont le travail ne coûte virtuellement rien à des entreprises qui se paient simultanément le luxe d'ignorer les impôts locaux. La disruption, c'est ça et rien d'autre.
Il est grand temps de dire les termes : la gig economy des années 2010 est un net négatif pour le bien commun, une arnaque à échelle mondiale. Partout où elle passe, le service public ne repousse plus. Le véritable talent de la techno-élite, cette classe de rentiers parasites dont Elon Musk est le plus répugnant exemple, c'est d'avoir su constamment réécrire une histoire d'exploitation, de fraude et d'opportunisme financier en une grande
épopée entrepreneuriale portée par des idéaux humanistes et
révolutionnaires, et d'adapter constamment le récit de sa domination aux
crises qui la menacent. En 2024, nous vivons désormais sous un régime économique plus proche du féodalisme que de l'économie de marché libérale, mais il y a encore des serfs (et certains ont même la carte de presse) pour défendre avec entrain ce braquage planétaire des ressources au nom du futur libertarien, suprémaciste et colonial de nos seigneurs, une keynote après l'autre.
Dernière victime de l'emmerdification généralisée du web millennial : l'information. À ce titre, 2023 est peut-être bien le chant du cygne pour une génération de journalistes web, celle venue au métier avec les pure players de la fin des années 2000 –notamment un certain Arrêt sur Images, lancé en 2007. En 2010, la Croix décrivait cette effervescence comme "un fait majeur" de la reconfiguration de l'information. Quinze ans plus tard, que – ou plutôt qui – reste-t-il ? Plus grand monde. Konbini a frôlé le dépôt de bilan en 2020. BuzzFeed et Vice ont fermé en 2018 et 2023, tout comme Brain, vitrine de l'intellol hipster des années 2010. Pour l'information gratuite aussi, le mirage économique des années 2010 a fini par se dissiper. (Je ne vous apprends rien, chèr·es abonné·es : un journaliste travaille mieux quand il est payé et indépendant des soubresauts de Facebook).
Pour ne rien arranger, rappelle le techno-critique Hubert Guillaud dans une excellente synthèse, Facebook, Twitter et les autres ont tout simplement arrêté d'essayer de diffuser de l'information – trop compliqué, trop coûteux, trop risqué. Résultat : depuis la pandémie, l'actualité a en partie été effacée des flux de contenu, constate le New York Times. En juillet, lorsque Facebook a décidé d'abandonner l'information au profit des tabloïds, Business Insider ou BuzzFeed ont perdu 70 à 80 % de leur trafic. La tendance est générale. Le Pew Research Center affirmait en octobre 2023 qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'Américains consommateurs réguliers d'information (38 % contre 52 % en 2018). Le trafic généré par les agrégateurs de news stagne, voire ralentit. Et puis il reste Twitter, dont l'emmerdification homérique a tout emporté sur son passage : le factuel, la réalité consensuelle, l'information, la confiance, l'actualité, le pluralisme d'idées. Notre génération a commis l'erreur de confondre multinationale et espace public, dirait Olivier Ertzscheid. Voilà ce qui arrive lorsqu'on confie des responsabilités à l'homme le plus riche du monde.
Dans un écosystème informationnel emmerdifié au-delà du secourable, le public semble avoir atteint un point de saturation, et troqué la connaissance de l'actualité contre la sauvegarde de la santé mentale. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout d'être informé. Et c'est peut-être alors de là que vient ce sentiment diffus de fin des temps qui semble toucher une partie de mes collègues, qui se demandent peut-être à quoi ils servent dans ce web-là. L'emmerdification généralisée a fait de nous des apatrides, écrit Wired. Nous voilà désorientés, obligés de désapprendre tous les réflexes, tous les usages que nous avons contribué à bâtir, sans savoir vraiment par quoi les remplacer. Sans savoir où aller. "Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et entre les deux surgissent les monstres", disait Gramsci. Ces monstres, ce sont les millennials paumés, errant comme des âmes damnées dans un espace numérique dont ils ne parlent plus la langue. Le futur du web ne nous appartient plus.
Cet article est libre d’accès
En vous abonnant, vous contribuez
à une information sur les médias
indépendante et sans pub.
Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous