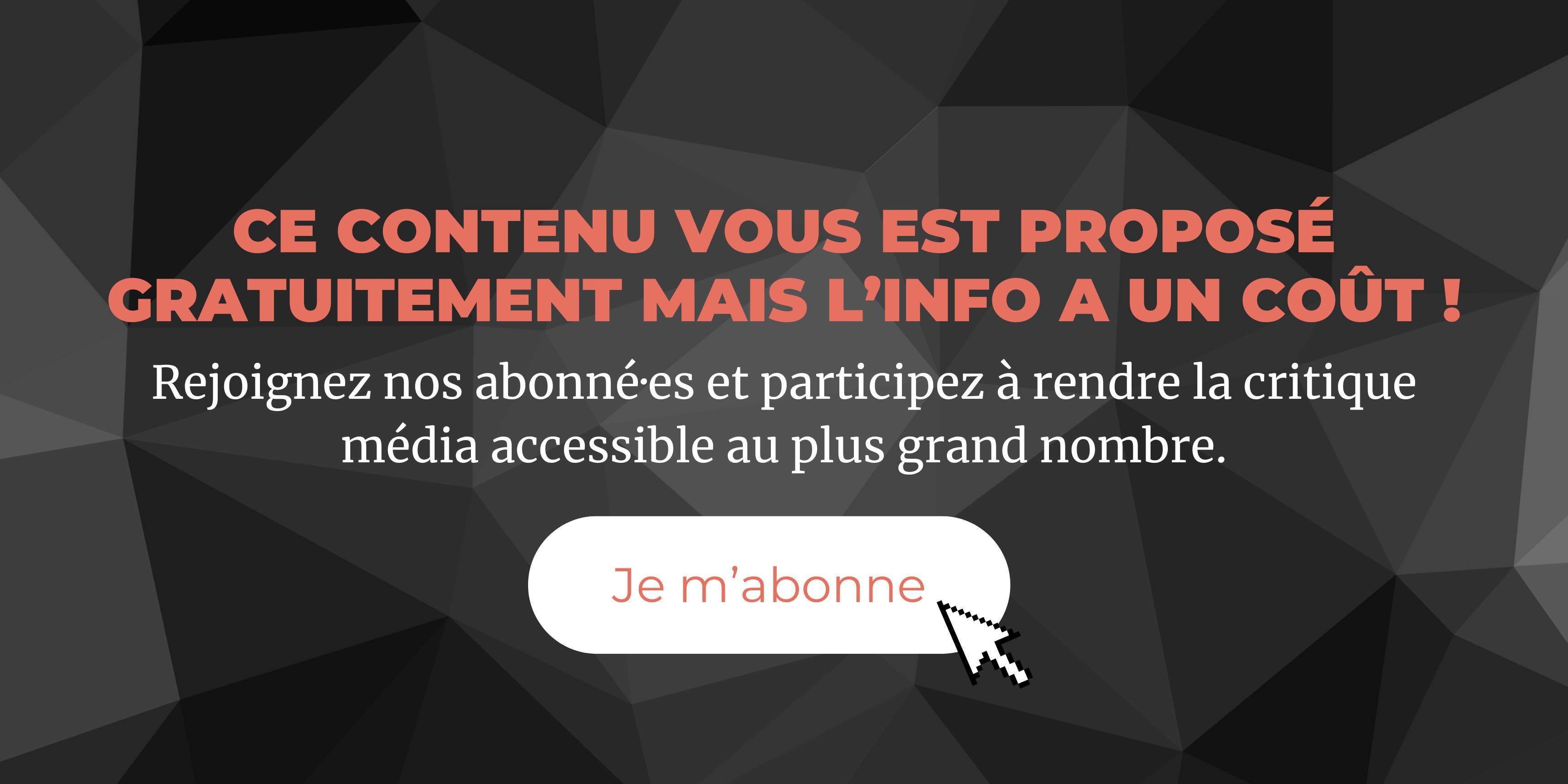Brésil/Roussef : "vague réactionnaire très forte" (Bastamag)
Si le processus de destitution de Dilma Roussef fait les gros titres au Brésil et dans le monde (parfois faussement présenté comme une affaire de corruption), l’épisode est symptomatique d’une division croissante de la société brésilienne, explique à Bastamag le journaliste et blogueur brésilien Leonardo Sakamoto, engagé dans la lutte contre "les formes modernes d'esclavage et pour les droits des travailleurs ruraux".
Dans la manifestation anti Dilma Roussef "qui a réuni un demi-million de personnes le 13 mars" on retrouvait ainsi majoritairement "des hommes blancs, membre de la classe moyenne élevée, avec des revenus importants [qui] demandent la destitution de la Présidente du Brésil – l’impeachment – à cause de la corruption" (alors même que les accusations contre la présidente portent sur une "astuce budgétaire" et non sur une affaire de corruption).
Surtout, "avec la crise politique et économique" qui secoue le pays depuis plusieurs mois, "des groupes de droite voire d’ultra-droite sont sortis du placard où les avait laissés la fin de la dictature civile-militaire". "Certains groupes sont encore plus conservateurs que le Tea Party nord-américain. Au parlement, cette ultra-droite est représentée par le député Jair Bolsonaro, ouvertement homophobe, raciste et misogyne. Les réseaux sociaux ont permis à certains groupuscules conspirationnistes et néo-conservateurs de gagner en notoriété. Ces groupes mènent une offensive réactionnaire contre les acquis sociaux. Il sont contre les allocations familiales, contre les quotas de personnes discriminées à l’université – dont bénéficient les Noirs, les Indiens –, contre les avancées en matière de droits humains et de mœurs – égalité homme-femme, droits des homosexuels et des transgenres. C’est une vague réactionnaire très forte, qui s’étend aussi au niveau mondial."
La faute aussi à la gauche au pouvoir qui n'a pas tenu ses promesses, en partie à cause du "système politique et la multiplicité des partis, ce que nous appelons la governabilidade", explique le journaliste. "Aujourd’hui, il existe 35 partis politiques dans le pays. Le Parti des travailleurs (PT) n’a jamais eu la majorité parlementaire dans les deux chambres (Congrès et Sénat). Il est obligé de former une alliance avec le PMDB [parti sans véritable ligne idéologique], qui compte le plus de députés élus. Le PMDB a participé au processus de re-démocratisation en 1985, après la dictature. Mais il est devenu un agglomérat d’intérêts personnels."
Des alliances qui ont empêché le PT de lutter efficacement contre la corruption, voire qui l'ont conduit à tomber dans ses travers. "Aucun gouvernement, depuis deux décennies, n’a réalisé une réforme politique réelle. [...] La seule avancée est la nouvelle loi qui interdit les financements des campagnes politiques par les entreprises [...] adoptée avec beaucoup de difficultés en 2015. L’autre problème est que la gauche brésilienne, lorsqu’elle a accédé au pouvoir, a adopté les méthodes politiques qu’elle critiquait auparavant : conclure des accords à tout prix avec d’autres partis, y compris les plus corrompus, pour disposer d’une majorité parlementaire. Et s’est de fait impliquée jusqu’au cou dans ces affaires de corruption. Ni Lula, ni Dilma n’ont détourné d’argent, mais leur parti, qui incarnait l’espoir du pays, a adopté des pratiques contraires à son discours."
L'occasion de lire notre observatoire : Non, Dilma Rousseff n'est pas destituée pour corruption!
Cet article est libre d’accès
En vous abonnant, vous contribuez
à une information sur les médias
indépendante et sans pub.
Déjà abonné.e ? Connectez-vousConnectez-vous